Gaza : une urgence humanitaire qui ne fait plus la une
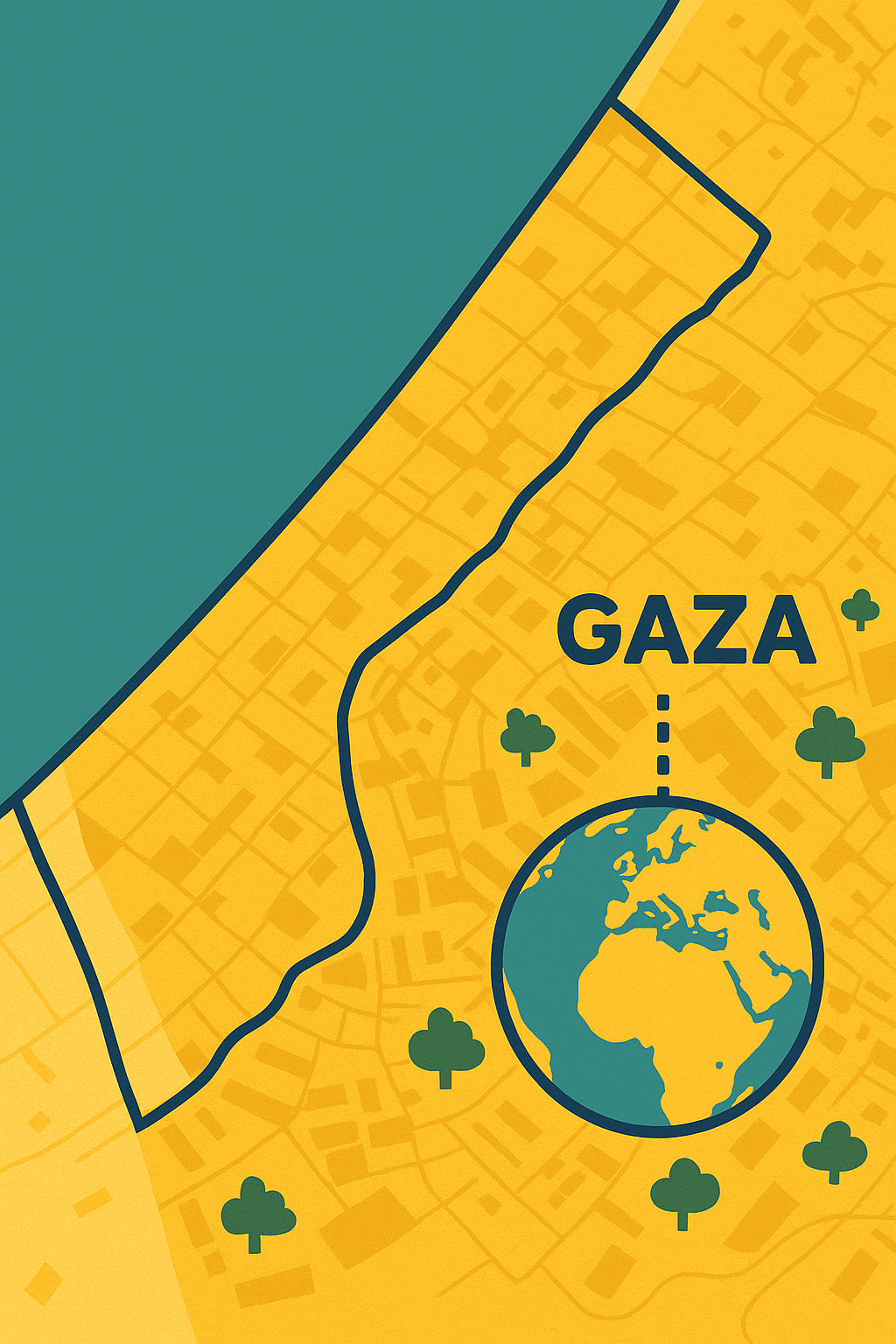
September 8, 2025
À Gaza, une crise humanitaire sans précédent se poursuit dans un silence croissant, entre famine, destructions massives et blocage de l’aide, laissant des millions de civils sans recours.
Depuis octobre 2023, Gaza vit au rythme d’une guerre qui ne faiblit pas. Les bombardements, les pénuries, les déplacements forcés. Le cycle est connu. Usé. Pourtant, les chiffres continuent de grimper. Et la situation, de s’aggraver.
Plus de 53 000 morts, dont une majorité de civils. 1,9 million de déplacés. Des hôpitaux à l’arrêt. Des enfants qui meurent de faim. Littéralement.
Mais dans l’agenda médiatique, l’urgence s’estompe. On parle d’“usure”. De “lassitude de la compassion”. Comme si une crise cessait d’être une crise parce qu’on s’y habitue.
Cet article ne cherche pas à choquer ni à accuser. Il dresse simplement un constat : Gaza traverse une catastrophe humanitaire massive, et les faits parlent d’eux-mêmes.
Froids. Clairs. Incontournables.
Les chiffres ne disent pas tout. Mais parfois, ils suffisent à montrer l’ampleur d’un désastre.
Depuis le 7 octobre 2023, plus de 53 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, selon les données compilées par le ministère de la Santé à Gaza et relayées par plusieurs sources internationales, dont le Centre d'information palestinien.
Parmi les victimes : une majorité de femmes et d’enfants. Le chiffre exact évolue chaque jour, mais l’ordre de grandeur reste le même : colossal.
À ces morts s’ajoutent plus de 118 000 blessés, souvent gravement atteints, et soignés dans des conditions extrêmes. La quasi-totalité des hôpitaux de Gaza est soit hors service, soit fonctionnelle à peine à 20 ou 30 %. Sans matériel. Parfois sans électricité.
Et ceux qui survivent ? Ils fuient. 1,9 million de personnes déplacées internes, soit environ 85 % de la population.
Des familles entières contraintes de fuir plusieurs fois. De dormir dans des écoles ou des tentes. De survivre avec moins de 1 litre d’eau potable par jour — bien en dessous du seuil d’urgence défini par l’OMS.
Les infrastructures de base ne tiennent plus.
L’électricité, l’assainissement, les écoles : tout est effondré ou inaccessible. On estime qu’il faudrait des années pour reconstruire. À condition que la guerre s’arrête. Ce qui, pour l’instant, ne semble pas à l’ordre du jour.
Quand une guerre dure, ce sont toujours les plus vulnérables qui paient le prix fort. À Gaza, ce sont les enfants.
Depuis le début du conflit, des milliers d’enfants ont été tués. L’UNICEF parle d’un “nombre effarant” et d’une “hécatombe inédite depuis la création de l’organisation” dans cette région.
Et pour ceux qui survivent, la menace ne vient pas que des bombes.
Elle vient de la faim.
Selon les dernières données de l’UNICEF, près de 50 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë sévère.
Le mot est technique. La réalité, brutale : c’est une malnutrition qui tue. En quelques jours. Parce que le lait est rationné. Parce qu’il n’y a pas d’eau propre. Parce que les soins les plus élémentaires sont devenus inaccessibles.
Les images venues du nord de Gaza rappellent celles de zones frappées par la famine. Ventre gonflé, visage figé, corps apathique.
Et pourtant, ce n’est pas une sécheresse. Ce n’est pas une crise climatique. C’est un siège.
Les convois humanitaires sont bloqués ou insuffisants. Le carburant manque. Et même quand l’aide arrive, les hôpitaux n’ont pas toujours les moyens d’administrer les traitements.
Mais au-delà des corps, ce sont aussi les esprits qui sont marqués.
Un enfant de Gaza aujourd’hui a vu la guerre, a perdu sa maison, a souvent perdu un ou plusieurs membres de sa famille. Il n’a plus accès à l’école. Il vit dans l’angoisse constante.
Ce n’est pas une vie. Ce n’est même plus une survie. C’est une attente suspendue.
L’UNICEF le résume simplement : “Chaque minute sans aide est une minute de trop.”
Dans toute crise, il y a ceux qui fuient, ceux qui restent, et ceux qui tentent d’aider. À Gaza, ces derniers se heurtent à un mur. Parfois littéralement.
Depuis les premières semaines du conflit, l’aide humanitaire est drastiquement limitée. Les points de passage sont filtrés, les autorisations rares, et les convois humanitaires sont souvent retardés, bloqués, voire visés.
Selon Amnesty International, la situation humanitaire résulte autant des combats que de restrictions délibérées à l’entrée de l’aide. Le carburant – nécessaire pour les ambulances, les générateurs, les camions – est rationné. La nourriture, elle, n’entre qu’au compte-gouttes.
Conséquence directe : les ONG ne peuvent plus travailler. Médecins, logisticiens, équipes de secours se retrouvent impuissants. Même les grandes agences internationales, comme l’UNRWA ou Médecins Sans Frontières, parlent de conditions inédites de blocage.
Dans certaines zones, aucune aide n’est arrivée depuis plusieurs semaines. Pas de vivres. Pas de soins. Pas de carburant. Rien.
Et quand l’aide passe, elle n’est pas toujours suffisante.
Un convoi humanitaire, c’est quelques camions pour des milliers de personnes. De quoi tenir quelques jours tout au plus. Dans un contexte où près de deux millions de personnes sont en situation d’urgence, l’écart entre les besoins et les livraisons est abyssal.
Amnesty parle d’“entrave systématique au droit humanitaire international”, et n’exclut pas l’hypothèse de crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité.
L’ONU, de son côté, alerte sur un risque de famine généralisée, surtout dans le nord de l’enclave.
Ce n’est pas une fatalité. Ce sont des choix politiques, militaires, logistiques.
Des choix qui ont un prix. Et ce prix, aujourd’hui, c’est la vie de civils. Surtout d’enfants.
Ce qui frappe, ces dernières semaines, ce n’est pas seulement l’intensité du conflit. C’est le silence autour de lui.
Au fil des mois, Gaza a disparu des gros titres. Les caméras se sont déplacées. L’attention s’est déplacée. Vers d’autres crises, d’autres conflits, d’autres échéances.
Et pourtant, sur le terrain, l’urgence ne faiblit pas. Elle s’aggrave.
Ce phénomène porte un nom : la lassitude de la compassion. Un terme pudique pour décrire un mécanisme bien réel. Quand une crise dure trop longtemps, elle devient une routine. On finit par s’y habituer.
Mais une guerre qui dure n’est pas une guerre moins grave.
Un enfant qui meurt aujourd’hui ne vaut pas moins que celui d’hier.
Le silence médiatique a des conséquences concrètes. Moins de visibilité, c’est moins de pression diplomatique. Moins de relais. Moins de dons. Moins d’attention politique.
Le risque, c’est la normalisation.
Accepter qu’un territoire entier vive sans eau, sans électricité, sans soins. Accepter qu’un million d’enfants soient privés d’éducation, de sécurité, d’avenir.
Comme si c’était “la nouvelle norme” à Gaza.
Certaines voix s’élèvent pour briser ce silence. Des journalistes, des ONG, des chercheurs. Mais elles peinent à franchir le mur de l’indifférence. Ou pire : de la résignation.
Rappeler les faits, documenter les chiffres, suivre ce qui s’y passe — ce n’est pas prendre parti. C’est refuser que l’oubli fasse le travail que les bombes n’ont pas terminé.
La guerre ne s’arrête pas aux frontières de Gaza. Ses répercussions, moins visibles, n’en sont pas moins profondes. Elles touchent des familles, des soldats, des sociétés entières, des deux côtés du mur.
En Israël, une autre forme de souffrance prend racine : celle de l’usure psychologique, du traumatisme prolongé, et parfois, de la rupture intérieure.
D’après une enquête de Courrier International, les suicides au sein de l’armée israélienne sont en hausse depuis le début du conflit. Un phénomène encore largement tabou, mais que plusieurs sources internes confirment.
Des soldats jeunes, souvent mal préparés à la violence de terrain, reviennent brisés. D’autres ne reviennent pas. Non pas tombés au combat, mais emportés par le poids moral de la guerre, ses dilemmes, son absurdité.
Ce mal est plus diffus, plus difficile à quantifier que les bombes. Mais il est là. Il sape la cohésion sociale. Il ronge les institutions. Il empoisonne les débats publics.
Et pendant ce temps, dans les camps surpeuplés de Gaza ou les abris de fortune, des générations entières grandissent sans école, sans structure, sans repères.
Une jeunesse entière exposée à la violence, privée d’avenir, souvent tentée par la radicalisation ou simplement consumée par le désespoir.
Cette guerre ne se contente pas de tuer. Elle détruit ce qui permettrait d’en sortir.
Ce qui se passe à Gaza n’est pas un épisode. Ni un “conflit de plus”. C’est une urgence humanitaire massive, prolongée, documentée.
Les chiffres sont là. Les témoignages aussi. Le droit international est clair. Et pourtant, l’inaction persiste. L’attention faiblit. Le réel, lui, continue de frapper — tous les jours, tous les soirs, loin des caméras.
Il ne s’agit pas ici de choisir un camp. Il s’agit de regarder en face ce que vivent des millions de civils piégés dans un engrenage qui les dépasse.
Il ne s’agit pas non plus de se flageller, ni de porter le poids du monde sur ses épaules. Mais de refuser l’indifférence, et de rappeler que la compassion, quand elle s’ancre dans les faits, n’est pas un luxe. C’est un réflexe de dignité.
Gaza est toujours là. La guerre aussi. Et chaque jour sans réaction renforce l’idée que cette violence est acceptable.
Elle ne l’est pas.
Prêt à donner du sens à vos dons ?
Rejoignez Generus, et devenez acteur d’un monde plus solidaire.